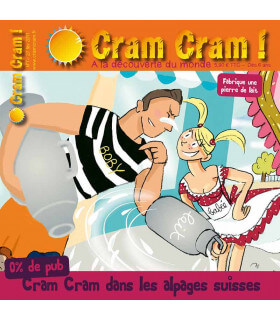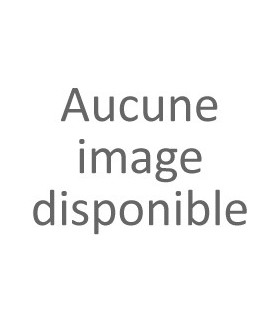Carnet de voyage en Suisse | En famille
La famille Flouriot a passé un été dans un alpage Suisse. Elle y a réalisé un carnet de voyage dans le magazine pour enfant Cram Cram. Le récit de leurs aventures au pays de la raclette !
Ceci est un mayen. Mais qu’est-ce qu’un mayen, me direz-vous ? Le mot désigne aussi bien un pâturage de moyenne montagne, que l’habitation, souvent sommaire, qui sert de refuge aux éleveurs suisses.
L’habitation se trouve à l’étage, on y accède par l’arrière du bâtiment. La porte du bas donne accès à l’étable. Ainsi, la chaleur animale réchauffe les habitants.
On emmène les vaches à l’alpage, de cette manière, les prairies de la vallée se reposent. De plus l’herbe y est plus saine et la température plus fraîche, ce qui permet à la vache de produire du meilleur lait pour le fromage, et en plus grande quantité.
Enfin, en broutant, les vaches entretiennent les alpages, ce qui réduit les risques d’avalanche lorsqu’il y a de la neige.
Les bergers que nous avons accompagnés se lèvent très très tôt, vers 3 heures du matin. Ils sortent les vaches de l’étable d’altitude, puis les emmènent sur un nouveau pâturage. Il faut alors planter la clôture autour des bêtes. Électrifiée ou pas, les vaches défoncent souvent la clôture ainsi posée ; les bergers doivent courir pour rattraper les bêtes échappées dans la montagne, et réparer les clôtures (photo 3). Toute la journée, sans répit, les cloches accrochées au cou des vaches tintinnabulent.
Entre 4 et 6 heures du matin, c’est l’heure de la première traite : une trentaine de vaches laitières passent dans l’étable mobile située près du pâturage (photos 4 et 5). Pour le lait, on emploie les vaches de race Holstein, Simmental ou Brown Swiss (photos 4,5,6), car elles donnent plus de lait que les Hérens noires.
C’est une traite motorisée, avec un moteur qui fait du bruit. Puis Patricia (photo 7) verse le lait récolté dans un grand bidon, monté sur une
remorque qu’un véhicule 4x4 vient ensuite récupérer pour l’amener à la laiterie. Une deuxième traite est effectuée en début d’après-midi. Après quoi il faut encore laver tous les instruments.
Mais voici la grande affaire des éleveurs suisses, ainsi que de leurs bergers : les combats de vaches. Au pâturage, tout au long de la journée, certaines vaches se battent entre elles. Elles le font naturellement, et ne sont jamais poussées par les bergers. Dès qu’un combat commence, le berger court vers les deux adversaires et empêche une troisième vache d’intervenir, car en prenant de flanc les deux premières, elle pourrait les blesser. Aussi curieux que cela puisse paraître, les vaches se blessent rarement dans ces combats. Les combats sont souvent brefs : 20 ou 30 secondes. Le berger note systématiquement le nom ou le numéro (inscrit sur le collier) de la gagnante. En fin d’après-midi, autour des pâturages, on voit de petits rassemblements d’éleveurs suisses, qui viennent observer les derniers combats. Le berger leur fait un compte-rendu précis des vaches les plus combatives. Sur l'une des photos, on voit un éleveur qui répare la corne d’une de ses vaches.
Une fois par an, un grand concours est organisé entre les vaches les plus fortes, à travers toute la vallée. Celle qui gagne est alors déclarée reine ; et c’est LA grande fierté pour son éleveur.
L’autre grande affaire des alpages est le fromage, celui dont on fait des raclettes. Gisèle, notre fromagère, commence par chauffer le lait de la traite à 32°C dans une grande cuve en cuivre. Elle verse
ensuite un produit appelé présure dans le lait, qui sert à le faire cailler. Elle continue à faire chauffer le lait. A 36°C, il donnerait de la tomme. Mais comme Gisèle veut de la raclette, elle le fait chauffer à 40°C. Étape suivante, elle tranche le caillé avec cet instrument qui s’appelle un... tranche-caille, justement. De temps en temps, elle prend les petits grains de caillé dans sa main pour voir s’ils ont la consistance adéquate. Enfin, elle récupère les petits grains de lait caillé avec un filet.
Gisèle place le caillé dans un grand bac carré, le laisse s’égoutter quelques instants, puis le coupe régulièrement avec une plaque de métal.
Enfin, elle prend les blocs de caillé ainsi tranchés et les place dans des moules à fromage. Pour finir, elle pose une masse assez lourde au-dessus du caillé. De cette façon, le caillé prend la forme du moule. Pour que cette forme soit régulière, elle va retourner plusieurs fois le fromage dans le moule pendant les heures qui suivent.
Avec 450 litres de lait, elle a préparé ce jour-là 12 fromages de 5 kilos chacun. Il reste ensuite à les affiner dans la cave.
En fin d’après-midi, Gisèle transporte ses 12 nouveaux fromages dans la cave. Elle les frotte avec une brosse, dans de l’eau salée où d’autres fromages ont déjà baigné (cela s’appelle la morge). Elle place ensuite les nouveaux fromages dans les rayonnages de sa cave, qui doit rester à 10°C. Mais sa journée est loin d’être terminée. Quotidiennement, il lui faut retourner et frotter un bon tiers des fromages déjà réalisés depuis le début de la saison. Une heure lui est nécessaire pour frotter et retourner 150 fromages. Comme chaque fromage fait 5 kilos, tu peux calculer la masse qu’elle déplace dans sa journée ! Il ne reste plus qu’à attendre trois à six mois, au minimum, pour pouvoir déguster le fromage... dans le mayen !